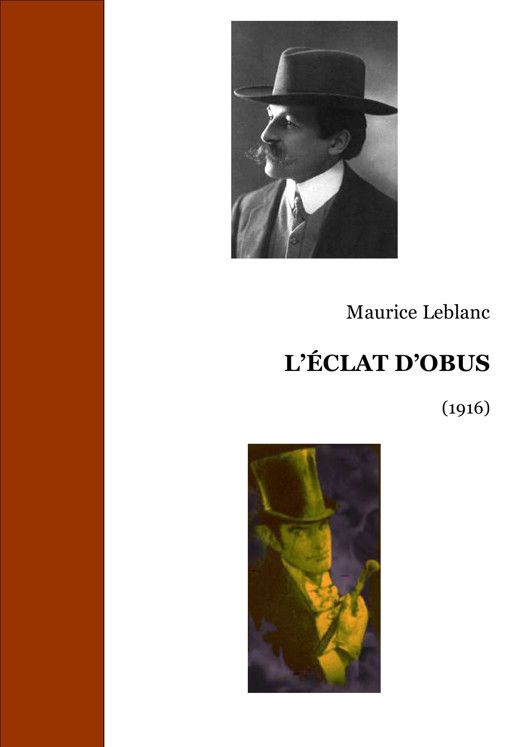
Collection: Livre 7 dans la collection Les aventures d'Arsène Lupin
�tiquettes: Policier, Lang:fr
R�sum�:
Un Arsène Lupin différent, plus noir et plus
violent, plus patriotique aussi, écrit pendant la
première guerre mondiale. Paul et Élisabeth Delroze
viennent tout juste de se marier. Se rendant au château
d’Ornequin, la propriété inhabitée des
parents d’Élisabeth, située non loin de la
frontière allemande, une terrible révélation
lance Paul sur la piste du meurtrier de son père. Au
même moment, la guerre éclate et Paul est
mobilisé...Comment Paul Delroze va-t-il continuer son
enquête alors qu’il part défendre son pays ?
Et comment expliquer ses souvenirs du meurtre de son
père, avec l’Empereur d’Allemagne
présent contre toute attente ? Entre la vaillance du
héros et un coup de pouce de Lupin, ce roman de guerre
et d’aventure entraîne le lecteur dans un monde de
trahison et d’actes de bravoure. Amateurs de
mystères, attention ! Ce livre vous entraîne dans
un univers d’intrigues et d’énigmes !
Serez-vous à la hauteur du plus grand cambrioleur de la
littérature ?